| EDITORIAL |
STAN LAW de
LAURISTON nous a fait part des ses réflexions de français à l’étranger. Ces
lignes ont inspiré l’éditorial de l’AP5 New’s 19.
Le Colonel FLAMAND nous revient avec quelques très belles
histoires vécues au sein du groupe Bretagne, cette prestigieuse unité créée en
pleine résistance après la défaite de juin 40. Selon ses mots, il faut retenir
de la vie de cette unité...
Une autre histoire à la gloire de nos mécanos et de leur intelligence : Le
tir au travers de l'Hélice...
La vie de tous les jours, courrier, les
ovnis....
Extraits cahiers de marche...
![]()
|
|
Bulletin de
l’association des personnels de la « 5 »
Base aérienne 115 – 84871
ORANGE Cedex
Téléphone/Fax :
04.90.34.65.30 |
New’s N° 19
|
|
|
|
|
EDITORIAL … La France : Nation, pays, patrie
Si le premier terme s’appuie
sur des critères objectifs organisationnels
et simples, les deux autres, le pays et la patrie sont plus difficiles
à saisir. Le PAYS « France » s’appuie sur
la géographie, sur les frontières, sur les territoires dont l’appartenance au
pays a fait notre histoire. L’exemple le plus frappant est la mutilation en 1870 avec l’annexion de l’Alsace Lorraine qui n’a pris fin
qu’en 1918 redonnant ainsi à la France un visage à nouveau
reconnaissable. Quant à la PATRIE « France », c’est l’ensemble
des valeurs conquises et acclimatées depuis des siècles : langue, civilisation, histoire et patrimoine,
pensées et droits de l’homme, c’est la continuité historique enracinée dans
le sol. Même sous sa forme la plus abstraite et la plus élaborée, le
patriotisme (l’attachement à la patrie) est l’affirmation de valeurs
justifiant qu’on les défende au besoin par la force car pour un patriote la
disparition de la patrie est un mal
pire que la guerre. Très belle et très bonne année 2001
pour vous et vos familles. P.S. :
Nouvelle présentation d’AP5 NEW’S plus conforme à notre appartenance, qui a
été préparée par J. DIEU et A. FOIX –
Merci. |
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
STAN LAW de
LAURISTON nous a fait part des ses réflexions de français à l’étranger. Ces
lignes ont inspiré l’éditorial de l’AP5 New’s 19.
Je viens de recevoir la
publicité d’un journal qui me prévient que « vivant actuellement en dehors
de l’hexagone », je devrais m’abonner à sa feuille de chou pour rester en
contact avec l’information de qualités « à la française ». Hélas, une
fois encore, il semble inéluctable que la France s’appelle « hexagone ». Peut-être cela tient-il au fait qu’aux yeux de certains
le mot France est laid ou désuet, et qu’il est avantageusement remplacé
par un nom de figure géométrique qui
décrit mieux les contours géographiques de notre pays. Ou alors peut-être a
t-on peur de nommer ce pays comme il le faut, mais pour quelle raison ?
Par crainte de susciter un nationalisme de mauvais aloi ? Parce que
« France » incommode ? Parce qu’il y aurait des relents de
honte ?
Au fait, les habitants de Corse
ont-ils reçu le même courrier que moi de la part de ce journal ? Parce
qu’eux non plus ne vivent pas dans l’hexagone. Ils sont en France, mais pas
dans l’hexagone. Et ceux de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de Guyane
et d’autres territoires d’outre-mer : privés d’hexagone ! Ils sont
français pas hexagonais (ou héxagoniens, tant il est vrai que l’Académie
Française - qui siège à Paris, dans l’hexagone - n’a pas encore délibéré sur le
nom qui sera donné aux habitants de l’hexagone). A moins que ce soit inutile
parce qu’ils sont français… et qu’ils habitent en France, comme les corses, les
martiniquais et les autres.
Nous sommes tristement tombés
dans le panneau de la mode de langage, sans réaliser le tort que nous nous
faisons. J’aime la France, je suis fier de dire son nom. J’aime quand un
britannique me dit avec les yeux de Chimène - et un accent langoureux -
« la belle France », j’aime quand un américain me dit fièrement qu’il
va aller en France (même s’il ignore où elle se trouve). J’aime quand on me dit
la France, Paris, l’amour, l’esprit, l’art, la culture, le jardin de l’Europe.
Mon pays, voyez-vous, c’est la France. C’est celui que m’ont légué mes ancêtres,
celui pour lequel beaucoup ont versé leur sang, et celui où je suis né. La
France, c’est aussi ce que je souhaite transmettre à mes enfants et à leurs
enfants. La France éternelle et intemporelle.
Un hexagone peut devenir un
jour un pentagone, une patatoïde, ou une lemniscate de Bernoulli (peu
souhaitable pour les contorsions que cela impliquerait). La France reste la
France ?
|
|
New’s |
N° 19
|
Page 03 |
Le Colonel FLAMAND
nous revient avec quelques très belles
histoires vécues au sein du groupe Bretagne, cette prestigieuse unité créée en
pleine résistance après la défaite de juin 40. Selon ses mots, il faut retenir
de la vie de cette unité :
« La souffrance due à l’inconfort prolongé, à
l’isolement dans un environnement hostile, une assistance inexistante, un
matériel inadapté, un armement trop léger. L’homme ne pouvait se ressourcer
qu’en lui-même, sans secours familial, sans soutien épistolaire face à un
ennemi qui ne voyait en lui qu’un hors la loi au lieu d’un combattant
loyal ».
Equipés de D 520 puis de Blenheim, les épisodes de ce
numéro traitent de la maîtrise de nos mécanos et de leur volonté
de vaincre. Le numéro suivant parlera des relations avec l’Armée de terre
FACE
AU PIEGE TECHNIQUE
Nous avons eu bien des surprises dont certaines eurent
des conséquences dangereuses comme l’obturation d’une pipe d’entrée d’air de
refroidissement du radiateur d’huile mettant en péril, en quelques instants, la
vie d’un moteur, cela, par l’entrée intempestive d’un charognard.
En revenant de Koufra, secteur très sec, un Blenheim, en
liaison Brazzaville Bangui, après deux heures de vol se « crash » en
pleine forêt vierge tropicale, les trois occupants de l’avant sont tués sur le
coup, dévorés dans la nuit par les « fourmis cadavres », les deux de
l’arrière, le mécanicien et le radio sont, malgré leurs blessures,
miraculeusement épargnés, ils apporteront, un mois plus tard, l’explication de
ce drame.
Sur Blenheim le décollage s’effectuait sur « inner
tank » car, en cas de panne moteur les consignes prévoyaient l’expulsion
par « vide-vite » du carburant des réservoirs extérieurs. Après un
décollage normal, en fin de montée, le mécanicien passait alors sur
« outer tank » jusqu’à épuisement du potentiel, environ deux heures,
pour revenir sur les intérieurs jusqu’à la fin du vol.
Toutes ces
manœuvres, commandées à partir d’un volant entraînant un câble coulissant dans
une gaine «bowden » (à l’image des freins de vélo) entraînant, par
rotation, un robinet d’ouverture-fermeture.
Alors que l’avion se trouvait à deux mille mètres le
mécanicien, au moment du changement de réservoir, découvre avec horreur, que la
commande est obstinément bloquée, les deux moteurs s’arrêtent et c’est la
disparition dans l’enfer vert qui se referme tel un tombeau sur ce malheureux
équipage.
Le radio, seul encore valide sauve le mécanicien atteint
d’une fracture ouverte du bassin, attaqué par les fourmis, en l’enveloppant
dans un parachute arrosé d’eau de Cologne, alors qu’elles dévorent pendant la
nuit, les dépouilles des membres d’équipage situés à l’avant de l’épave. Ces
fourmis (Magnans) agissent en colonnes d’une trentaine de mètres, sur environ,
quarante centimètres de large et mesurent chacune, entre quinze et vingt
millimètres.
Au matin, comble de l’horreur, le radio découvre les
squelettes complètement nettoyés de ses camarades avec seulement les yeux
épargnés…
Dans le
silence, la quasi-obscurité, l’odeur de cadavre insupportable, tenace,
caractéristique de ces fourmis, pour se donner du courage, toutes les minutes
environ, il introduit une cartouche dans la mitrailleuse et tire dans l’espoir
incertain d’être entendu. Le miracle eût cependant lieu car, après plusieurs
jour, des pygmées de la région d’Imfondo, en chasse au voisinage du lieu du
« crash », apeurés par les tirs intempestifs, sont allés prévenir le
chef du village le plus proche, au bord du Congo, qui, tirailleur-clairon
retraité, guidé par les indigènes, donnait un coup de clairon en réponse à un
tir, les sauveteurs parvenaient ainsi jusqu’à l’épave.
Les deux rescapés, un mois plus tard, rejoignaient Bangui
en pirogue et pouvaient expliquer l’origine du drame. L’explication technique
du blocage reposait en fait sur la dilatation des guides (klingérite) de la
gaine du câble de commande, due à l’augmentation de l’humidité relative très
élevée en zone tropicale alors que le serrage avait eu lieu en secteur
particulièrement sec. L’avarie était due au choix d’un matériau instable. Il
s’agissant bien d’un piège.
La liste des initiatives, des actions quotidiennes de
vigilance, serait très longue à exprimer. Certaines de ces actions ont sauvé de
la réforme des avions, qui, grâce à la volonté farouche de ces hommes isolés ont
pu continuer le combat tel cet adjudant responsable du Glen Maryland nr.
B.J.428. Toute la partie arrière, du bord de fuite des ailes jusqu’aux
gouvernes de profondeur, fût à remplacer, après un « crash ». A
partir d’un ensemble récupéré sur un autre avion accidenté, en fondant et en
usinant à la main des rivets impossibles à se procurer par les voies
officielles, ce mécanicien réussit, seul, en plein zone désertique, avec
quelques Tirailleurs, à remplacer toute la partie accidentée du «Glen ».
C’est cet avion, qui quelques mois plus tard, lors de la seconde campagne du
Fezzan - janvier, février 43- capturait, grâce à l’audace de son pilote, près
de 200 italiens surpris en plein désert, avec leur échelon roulant armé.
Un autre cas, un peu différent, mérite d’être cité car il
relève du même état d’esprit, celui d’un autre mécanicien, qui de sa propre
initiative, a réussi à récupérer deux hélices commandées au Caire, son avion
posé sans gros dommages sur le ventre en plein désert il décide de creuser sous
les fuseaux moteurs, et après avoir sorti et verrouillé le train
d’atterrissage, avec une trentaine de Toubous, en tirant l’avion en le faisant
rouler sur un plan incliné pratiqué devant les roues : ainsi le
«Glen 228 » fut remis en ligne en moins d’une quinzaine alors que la
hiérarchie l’aurait considéré comme épave.
Le
Bretagne avait aussi ses « petits pinailleurs ».
La défense arrière du Blenheim, chacun en était bien
conscient, avec une seule mitrailleur 7.7 était très faible. Ce n’est que fin
41 que les nouveaux modèles furent livrés en Afrique, avec un jumelage. Si
encore on nous avait employés en vol de groupe, c’eût été plus astucieux,
non ! Un avion tout seul, alors qu’un C.R. 42, même avec ses performances
modestes disposait de deux 13.2 à tir axial, capable d’ouvrir le feu à cent,
voire deux cents mètres efficacement avant nous.
Cette faiblesse rend le fait d’arme de mon camarade JEAN
Edmond encore plus remarquable.
Alors que nous étions basés à « Gordons’Three »
près de Kartum au confluent Nil blanc, Nil bleu (point réputé le plus chaud du
globe) au mois de mai 41, en mission solo dans la région de Gondar (lac Tana,
Abyssinie) il est attaqué par deux C.R. 42. La surprise est totale car nous
Le chasseur connaît manifestement la faiblesse du
bombardier et se place en dessous de la ligne de tir du mitrailleur limitée par
la sécurité qui protège les plans fixes. Par deux fois l’attaquant passe
au-dessus de cette ligne en lâchant une longue rafale mais la riposte du tireur
de la tourelle il revient s’abriter sous l’axe protecteur de l’empennage.
Le grand mérite de
JEAN est, d’abord, de n’avoir pas perdu son sang-froid et ensuite d’avoir su
imaginer et anticiper ce que serait la prochaine action du chasseur. Lorsque ce
dernier vint, pour la troisième fois, se placer en position de tir, notre
mitrailleur était déjà placé, là, où il le fallait pour lâcher en plein moteur
de son ennemi une rafale de petit calibre, certes, mais longue et de 1 200
coups / minute… L’affaire n’a duré guère plus d’une minute, la fumée aux fesses
le C.R. 42 est allé se « crasher » dans la nature ; le second
jugeant l’entreprise trop risquée, abandonne le combat.
Cette aventure heureuse, s’ajoutant à la célébration de
la Sainte Jeanne d’Arc, eût un grand retentissement dans la
« Military-Police » qui eût de grandes difficultés à expulser, cette
nuit là, les Français des quartiers chauds déclarés « out of bunds »
de la banlieue de KARTHUM…
Cette réussite, bien que renforçant le moral des équipages
et celui des radio-mitrailleurs en particulier n’effaçait pas complètement le
sentiment de vulnérabilité arrière du Blenhein même en doublant sa puissance de
feu.
C’est alors qu’un perfectionniste bricoleur, persuadé de
surprendre tout le monde et surtout ses adversaires, entreprit de se pencher
sur cette satanée sécurité de tir automatique. En vérifiant de plus près, il
s’aperçut avec une règle optique, que la ligne de tir de canons des
mitrailleuses passait largement au-delà des bords d’attaque des plans fixes
horizontaux et verticaux. Persuadé de faire l’admiration de tous, il s’engage
secrètement dans une modification très simple et, encore aujourd’hui, on se
demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt !
Armé d’une simple lime, en cachette pour ménager son
effet, après plusieurs visées, il modifie les cames métalliques qui commandent
le blocage du tir. Impatient d’avoir la
preuve qu’il a bien trouvé le fil à couper le beurre, il demande un d’essai et
confiant dans l’extrême finesse de son travail, il largue une longue rafale en
travers de l’empennage. Il n’y avait plus qu’à le changer. Les vibrations et
les oscillations dues au flux de l’air avaient eu raison de ce savant bricolage
un peu trop « pinaillé ».
Pour la petite histoire, l’intéressé, mortifié jusqu’à
l’os s’est spontanément mis en quarantaine, s’isolant sous son avion pour y
dormir, s’y nourrir de biscuits et de « corned-beef » évitant ainsi,
les sourires sarcastiques de ses petits camarades…
![]()
|
|
New’s |
N° 19
|
Page 06 |
Une autre histoire à la gloire de nos mécanos et de leur intelligence…
Le
tir au travers de l’hélice
Quand
les hommes inventèrent l’avion, ils pensèrent d’abord à voyager plus vite avec
ce nouveau moyen de se déplacer. Puis, à la première occasion, 1915 en
particulier, ils ressentirent le besoin d’aller canarder les gens d’en face,
lesquels pensaient exactement la même chose, comme il fallait s’y attendre.
Ils
se servirent pour cela d’abord d’un mousqueton, dont on peut voir un exemple au
Service Historique de l’Armée de l’Air au château de Vincennes. Mais cette arme
ne provoquant pas assez de dégâts à leur goût, les hommes installèrent sur
leurs avions des mitrailleuses plus meurtrières. Hélas le pilote de chasse n’a
que deux bras et le maniement d’une mitrailleuse, avec tout ce que cela
comporte de manipulations, exige ces deux bras prolongés de mains expertes.
A l’époque, les avions ont
des hélices, qui tournent sur le nez de l’avion, et empêchent la mise en place
d’une mitrailleuses sur le capot, devant le pilote. En effet, si l’on tire de
cet endroit, les balles vont aller détruire l’hélice, faisant ainsi perdre à
l’avion une grande partie de son efficacité. Bien sûr, très vite, il y eut des
gens intelligents pour blinder les hélices*, et les balles passaient
quelquefois à côté des pales ; quelques-unes unes percutaient l’hélice,
ricochaient dans tous les sens ; les autres, moins nombreuses,
atteignaient leur but, mais rarement.
On
sait que c’est monsieur Fokker qui inventa vraiment le système permettant de
tirer à travers l’hélice sans en toucher les pales, avec une petite came sur
l’arbre de transmission. Cette came bloquait le tir quand la pale passait, ne
permettant le passage de la balle qu’au moment où l’hélice était horizontale au
cours de sa rotation.
Ayant
découvert le secret sur une avion allemand abattu, les français se dépêchèrent
d’imiter les alliés centraux, comme on les appelait à l’époque, et la petite
came miraculeuse prit très vite sa place dans les moteurs.
Mais
on ne transforme pas en quelques semaines des centaines d’appareils, et il
fallut dans un premier temps instruire les mécaniciens en grand nombre. C’est
là qu’intervient dans l’histoire un ingénieur fameux sorti major d’une Ecole
prestigieuse. Cet homme au cerveau puissant fut chargé d’expliquer aux autre le
grand principe du tir à travers l’hélice, il le fit le mieux du monde, hélas
avec des termes trop académiques, des formules impropres à pénétrer dans des
têtes simples et prolétariennes.
Heureusement
Bébert était là ! Le vieux mécanicien amoureux de son métier possédait à
la fois des mains de fée et des moyens d’expression percutants, il savait
parler aux hommes, avec des gestes, des grimaces, des mots chocs, on dirait
aujourd’hui qu’il avait des talents pédagogiques.
Pour
exposer le système du tir à travers l’hélice, il se mit face à deux jeunes
mécaniciens et commença à tourner un bras dans le sens des aiguilles d’une
montre, décrivant ainsi des cercles rapides devant sa tête. En même temps, il
crachotait des postillons avec sa bouche dans la direction des mécanos,
lesquels recevaient en pleine figure mille gouttes de salive, ceci avec une
certaine répulsion !
« Ça, c’est l’ancien truc » dit Bébert «je reçois les postillons sur ma manche et quelques-uns uns vont sur vos bobines, très peu comme vous pouvez le voir ». Et il passa au « nouveau truc » c’est-à-dire qu’il ne crachotait que lorsque le bras ne passait plus devant sa bouche. Les mécanos reçurent au cours de ce second exercice une plus grande quantité de postillon, ce dont ils se rendirent compte avec beaucoup de crainte pour une éventuelle contagion. Après cette démonstration lumineuse, Bébert s’assura que tout le monde avait compris et fut satisfait de la réponse unanime de ses élèves.
On
devait apprendre un peu plus tard que deux ou trois mécaniciens étaient restés
sourds aux explications pourtant excellentes de Bébert, mais redoutant le
postillonnage organisé de leur professeur, ils avaient déclaré leur
reconnaissance éperdue devant tant de talent pédagogique.
Mais Bébert, qui savait
tout, et en particulier lire la compréhension dans les yeux des ses élèves,
convoqua les deux menteurs et décida de refaire l’expérience avec un tuyau
d’arrosage. Cette fois les mécaniciens comprirent à 100 % car on était en
décembre, et l’idée d’être inondés plusieurs fois de suite ouvrit béantes la
compréhension, la mémoire, et la perception de toute chose.
La
rotation rapide des bras de Bébert et ses crachotements itératifs furent
reconnus à l’époque comme le meilleur moyen d’enseigner, à peu de frais, le
système du tir à travers l’hélice. Il paraît que Bébert agrémenta plus tard sa
démonstration en levant le pouce de l’autre main restée collée contre le corps,
ce qui tenait lieu de came, détail technique de première importance !
* Déflecteurs
d’hélice, inventés par Vedrines.
top
![]()
|
|
New’s |
N° 19
|
Page 08 |
Courrier des lecteurs…qui intéressera Denis Letty ancien
commandant de la 5 et spécialiste reconnu des OVNI
« Messieurs,
Votre
article paru en première page de votre édition du 1er août et
intitulé « l’astronaute… » a retenu toute mon attention.
J’ai en
effet, il y a déjà de très nombreuses années, été consulté par les membres
d’une commission qui enquêtait sur le phénomène « OVNI » , du
fait que j’avais en 1950 et 1951 commandé un Groupe de chasse basé à ORANGE (Vaucluse), équipé du chasseur à réaction
britannique « VAMPIRE », dont une patrouille avait été témoin de la
présence d’un «OVNI» dans le ciel de Provence.
Un jour
comme les autres de cette période, je fus appelé de toute urgence à la tour de
contrôle de la Base pour y apprendre qu’une patrouille de mon groupe, composée
de deux « VAMPIRES » pilotés par deux aviateurs chevronnés, le
lieutenant Galibert accompagné du
sergent-chef Prio également très
qualifié, signalait poursuivre à 10 000 mètres d’altitude un « objet
volant » qu’elle n’identifiait pas. Au moment où j’arrivais au contrôle le
contact visuel précité venait d’être rompu car « l’objet volant » en
cause avait repris une altitude inaccessible au « VAMPIRE ». Cette
scène s’était déroulée au-dessus de Toulon/Saint-Mandrier.
Ce
n’est que beaucoup plus tard, lorsque l’existence des vols clandestins américains
du planeur secret motorisé U2 fut divulguée, que je compris que l’événement
rapporté ci-dessus était dû à la présence dans le ciel de notre pays d’un U2.
Cet aéronef était prévu pour des altitudes inaccessibles aux radars et aux
chasseurs de l’époque. Je suppose que parfois le pilote s’enhardissait à
descendre aux environ de 10/12 000 mètres afin d’obtenir de meilleurs clichés.
Selon
mes souvenirs la Commission sus indiquée n’avait à l’époque retenu que trois
cas «d’OVNI», un autre, notamment, étant apparu aux environ de Reims. Le troisième avait été considéré
comme douteux. »
Jean-Marie VAUCHY - Saint-Cloud,
le 1er août 2000
Colonel et navigant, honoraire, de l’Armée de l’Air
|
|
New’s |
N° 19
|
Page 09 |
Extrait
du Cahier de marche du 02.00 – Février 1964
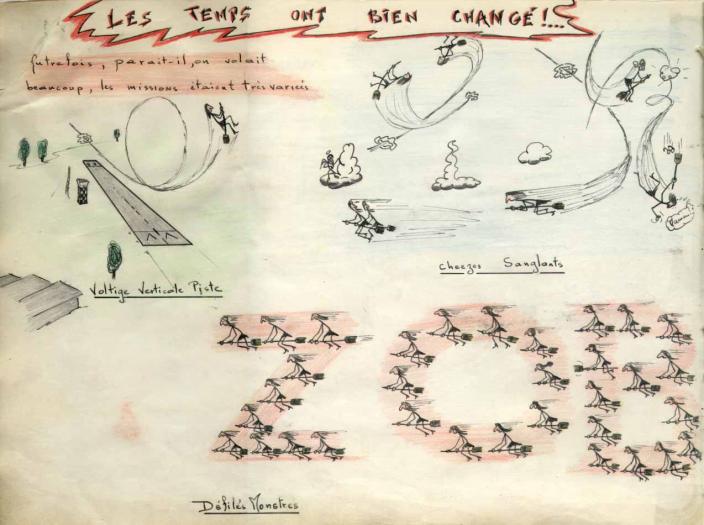
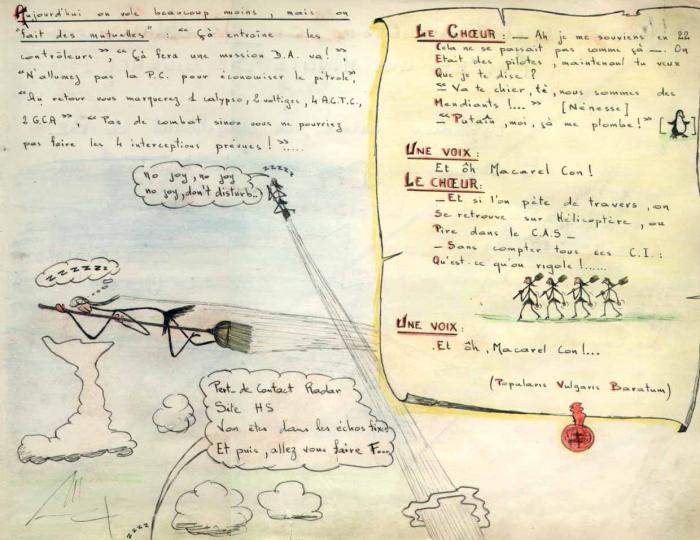
Extrait
du Cahier de marche du 02.005 – Février 1964
Pour ceux qui ne sont pas au courant : le
CD-ROM des cahiers de marche
du 2/5 (janvier 64 à décembre 77) et du 1/5
(novembre 59 à décembre 81)
est disponible au prix de 550frcs.(s’adresser à Jean-François
Orssaud)
Vous y trouverez plus de 1800 pages et plus de
3000 photos et dessins ! TOP
|
|
New’s |
N° 19
|
Page 10 |
Il nous
a quittés…
THIERRY Emile
Le Général E. Thierry est mort le 14
septembre 2000. C’était un as de guerre avec 7 victoires. Il a assisté très
régulièrement aux manips de la 5° E.C.. Il a commandé la « 5 » en
1950. Homme d’une très grande vivacité, doté d’un humour superbe, il nous a
séduit par son intelligence, sa force de caractère, sa rigueur morale et sa
grande sensibilité.
Je consacrerai un article dans le
prochain AP5 New’s au général Thierry qui m’avait fait l’honneur de me remettre
mon brevet de pilote le 28 mai 1960 à MEKNES.
top
**************************************************************************************************
MODIFICATIF N° 4 A L’ANNUAIRE DE L’A.P. 5
au 15 septembre 2000.
Changements d’adresse
|
JAFFRES Patrick |
BA 102 - E.E.T.I.S. 62.530 B.P. 8310 |
21083 DIJON CEDEX 9 |
|
EISENBEIS Henri |
307, Boulevard des Ligures |
83380 LES ISSAMBRES |
|
BRUGNON Michel |
5, Boulevard de l’Orient |
30133 LES ANGLES |
|
SWITZER Henri |
Commandant de la B.A. 112 |
51090 REIMS CEDEX |
|
NICOLAS Jean-Pierre |
SP 85014 |
00803 ARMEES |
|
ROS Didier |
11, Résidence LANCLOS |
31380 Montrasuc
la conseillere |
|
MOULIN Luc |
B.A. 123 |
45037 ORLEANS CEDEX |
Ils ne nous ont pas transmis leur nouvelle adresse …
Patrick ZAMBELLI
Claude VALENTIN
Quelques amis sont venus nous rejoindre ….
|
TEYSSONNIERES Bernard |
Commandant la B.A. 115 |
84871 ORANGE CEDEX |
|
MARTIN Christine |
Quartier Clos Cavalier |
84100 ORANGE |
|
RATTE Jean-Louis |
7, rue Lamartine «les Oléandres » |
06150 CANNES LA BOCCA |
|
VAN DE VOORDE Jean-Michel |
20, rue Marie Curie |
84850 CAMARET |
|
MICHEL Gérard |
Quartier «les Patifiages » |
84100 UCHAUX |





